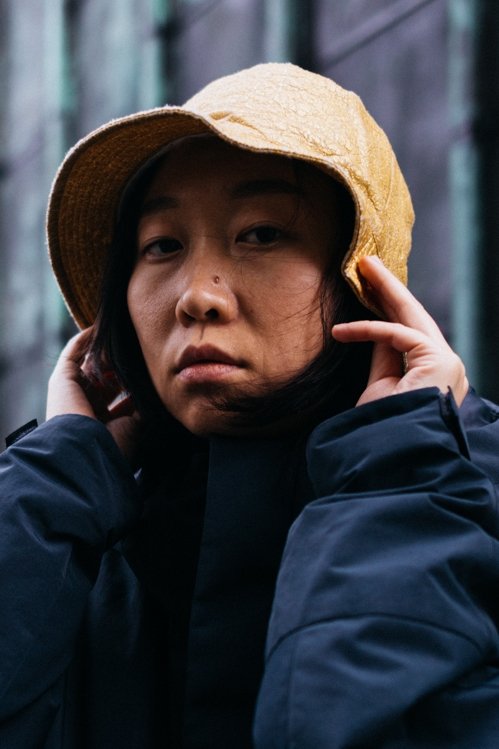Dans une chambre d’hôtel, deux jeunes femmes rêvassent et se filment. Souvent nues ou à demi, dans les draps froissés ou dans le bain. Ou bien postées à la fenêtre, à scruter la rue en bas, attendant que quelque chose se passe. Mais rien ne se passe. Dehors, le monde est sur pause. Ne reste qu’à passer le temps. En se racontant des histoires, des souvenirs. En revenant en arrière, ici et là. En faisant des sauts dans le temps et la mémoire, laissant derrière soi la porte ouverte aux fantômes…
Parce qu’au fond n’est-ce pas ça, le « jet lag » ? Cette sorte de pas de côté hors de la chronologie telle qu’on la perçoit d’ordinaire ? Ce moment étrange où l’ordre normal des choses se trouve bousculé, déréglé, sens dessus dessous ? On ne sait plus si on est aujourd’hui, hier ou demain. En Autriche, en Chine ou ailleurs. En 2018, 2020 ou 2021… Au gré des conversations, les souvenirs remontent à la surface d’un présent mis sous cloche. Commence un voyage intérieur qui nous fait glisser d’une époque à une autre, d’un pays à un autre, d’une histoire l’autre… Comme plusieurs films en un. Le récit intime et familial d’une femme déjà vieille, sur les traces d’un père déjà mort. Celui d’une pandémie mondiale, devant laquelle la réalité prend soudain des allures de film de SF. À moins qu’il ne s’agisse d’une dystopie politique : l’histoire d’une armée se retournant contre son gouvernement, renversant la démocratie en place pour prendre le pouvoir ? Sauf que tout est vrai. Que ce voyage, c’est celui de la grand-mère de la cinéaste et de sa famille venues assister à un mariage, et tenter d’éclaircir le mystère qui les hante. Que le coup d’État politique, c’est celui orchestré par les militaires de Birmanie (ou Myanmar) en 2021, et ses conséquences pour la population. Quant à la pandémie, et bien…
Jet Lag est un grand film de fantômes. Le monde qu’il dépeint ressemble à un monde d’après l’Apocalypse — mais comme si cette Apocalypse avait eu lieu en silence, et qu’il fallait bien continuer malgré tout. Un monde en suspension, en dehors du temps : le monde du confinement qui, devant la caméra de Zheng Lu Xinyuan, réapparaît dans toute sa troublante irréalité. L’aspect granuleux des images (filmées en DV et à l’iPhone) renforce encore le caractère à la fois spectral et étrangement familier de l’ensemble. D’autant que la cinéaste a eu la bonne idée de passer le tout au noir et blanc, achevant de brouiller les repères entre passé et présent, entre les vivants et les morts.
Dans ce temps incertain resurgissent des figures disparues, comme nimbées de mystère. À commencer par cet arrière-grand-père à la vie romanesque, sur lequel on sait peu de choses assurément, et dont la disparition volontaire se révèle peu à peu comme un traumatisme fondateur pour la famille. Le film est ainsi peuplé de nombreuses présences invisibles : que ce soit celles qui hantent les lieux, bâtiments et rues désertés (lors de quelques belles scènes de déambulations nocturnes), ou encore ces figures d’hommes qui brillent par leur absence ou leur indifférence — à l’image du père de la cinéaste elle-même, qui ne peut supporter longtemps d’être filmé.
Sous le regard scrutateur d’une jeune femme pour qui la caméra est comme une extension de l’œil et du corps, crise mondiale et récits familiaux s’entrechoquent. Jet Lag dégage ainsi un sentiment d’hyper-intimité — entre pudeur et exposition franche — doublé d’une dimension presque clandestine, renforcée par la situation sanitaire et le contexte politique instable du Myanmar (duquel la cinéaste prend des nouvelles par écrans interposés). Les fils qui relient tous ces éléments épars semblent parfois bien ténus. Tout le propos de Zheng Lu Xinyuan est là pourtant : entremêler l’intime et le politique. Montrer que toutes les histoires, la grande comme les petites, sont faites de la même matière. Et que c’est bien le rôle du cinéma que de malaxer tout ça ensemble, d’établir des liens impossibles pour faire tenir les choses entre elles, envers et contre tout…
Une manière comme une autre de résister à l’écrasante fatalité de l’Histoire et du temps.
Clément Massieu